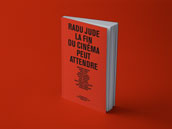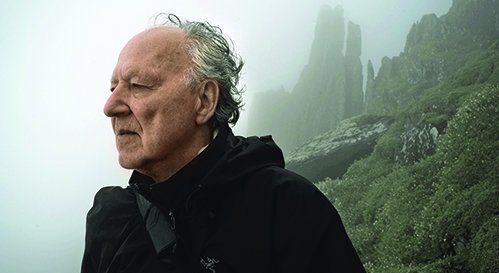Radu Jude : « Il faut à la fois aimer et haïr le cinéma »

Photo © Silviu Ghetie/Micro Film
Cyril Neyrat — D’où, comment est venu ce besoin de plonger dans le passé sombre de la Roumanie ?
Radu Jude — Pour ma génération, les années 1990 ont été la découverte d'une histoire nationale très différente de l’Histoire officielle. La dictature de Ceaușescu était très nationaliste : c’était la même idée du peuple roumain, de ses origines, dans les mêmes termes que dans la période fasciste, qu’on retrouve aujourd’hui dans le nationalisme de l'extrême droite soi-disant souverainiste. Sans l’antisémitisme explicite, mais avec la xénophobie, la mythologie folle des origines, le mépris pour les minorités. Les Roms n’existaient pas du tout dans cette idée de l’histoire. Après la révolution de 1989, ce fut un grand choc pour ma génération de découvrir dans des livres d’histoire l’esclavage des Roms et la participation de la Roumanie à l’Holocauste.
Pour ma génération, les années 1990 ont été la découverte d'une histoire nationale très différente de l’Histoire officielle. La dictature de Ceaușescu était très nationaliste : c’était la même idée du peuple roumain, de ses origines, dans les mêmes termes que dans la période fasciste.
Radu Jude
J’avais lu Cioran, toute cette génération était devenue comme un modèle pour nous. Puis j’ai lu l’horrible vérité sur Cioran, sur son engagement fasciste fou — pas seulement lui. C’est intéressant comment la propagande fonctionne. Toute notre jeunesse, à l’école, on nous répétait que nous, les Roumains, sommes une sorte d’entité spéciale, qu’on avait toujours été les victimes des autres, une nation qu’on n’avait jamais laissé se développer comme elle l’aurait pu, qui avait défendu l’Occident contre les Ottomans et qui, à cause de ce sacrifice, n’avait pas pu se développer, etc. On te répète ça et ça marche. Tu ne te sens coupable de rien. Et quand soudain tu lis des livres sur les pogroms, l’Holocauste… Pour moi ça a été un effondrement. J’ai commencé à me renseigner, pas pour des films à faire mais d’abord pour en savoir plus sur l’origine de ce que nous sommes aujourd’hui. Et j’ai réalisé que les mêmes questions revenaient car le travail n’avait jamais été fait. On dit souvent que je m’intéresse à l’histoire, mais non, je ne m’intéresse pas à l’histoire, je m’intéresse à la trace de l’histoire dans le présent, de cette histoire noire, cachée, pas reconnue.
C.N. — Votre stratégie fut d’abord d’injecter de l’écrit, du texte dans les films.
R.J. — Dans Scarred Hearts (Cœurs cicatrisés, ndlr), j’ai mis des pages du Journal de Mihail Sebastian, un proche de Blecher, écrivain juif de la même génération, ami avec tout le monde, Cioran, Eliade, Ionesco. Dans ce journal tenu tout au long des années 1930–1940, on peut lire le processus de rhinocérisation des gens autour de lui : Cioran et Eliade sont de plus en plus antisémites, les gens commencent à l’éviter. C’est un document très fort, très bien écrit. Quand je l’ai lu j’ai été malade pendant deux jours.
Aujourd’hui certains prétendent que c’était programmatique, que j’avais conçu un programme de films contre la Roumanie. Alors que j’ai fait ces films l’un après l’autre, par nécessité intime. Après cinq, six, sept films, je me suis dit que oui, j’avais sans doute un programme inconscient. J’étais obsédé, ces films se sont enchaînés avec beaucoup de facilité. Et aujourd’hui c’est terminé. Pour le moment, cette histoire roumaine ne m’intéresse plus.
C.N. — Cette période très intense de quelques années a été cruciale dans l’évolution de votre cinéma, de votre écriture filmique.
R.J. — Oui, c’est en plongeant dans le passé que les questions formelles sont devenues plus importantes pour moi. Dans mes premiers films je voulais juste raconter une histoire, le faire bien, je ne pensais pas beaucoup aux questions de représentation. Mais quand j’ai commencé à travailler sur l’Histoire, avec Aferim!, ce questionnement est devenu obligatoire. Comment faire le film aujourd’hui ? J’aurais trouvé très problématique de le faire exactement comme un film contemporain, notamment au niveau du langage.
C’est là que j’ai découvert mon goût pour la citation. J’ai d’abord écrit un scénario conventionnel avec des dialogues d’aujourd’hui, que j’ai voulu adapter dans le langage de l’époque. Mais qu’est-ce que ça veut dire un dialogue du 19e siècle alors qu’il n’y a aucune trace vidéo ou audio de la langue parlée ? J’ai travaillé avec une consultante historique mais j’ai beaucoup aimé faire moi-même le travail de recherche. J’ai commencé à lire des documents, de la littérature, à noter des phrases, des mots, et tout d’un coup c’est devenu une méthode : tout le dialogue est fait de citations prises dans des documents ou dans la littérature populaire de l’époque. C’est une langue parfois incompréhensible, lourde, avec beaucoup de mots grecs ou turcs, car le roumain n’avait pas encore subi l’influence française.
C’est en plongeant dans le passé que les questions formelles sont devenues plus importantes pour moi. Dans mes premiers films je voulais juste raconter une histoire, le faire bien, je ne pensais pas beaucoup aux questions de représentation.
Radu Jude
Comme j’ai beaucoup aimé faire ça, je l’ai refait ensuite pour Scarred Hearts : beaucoup de dialogues sont des citations de romans, du Journal de Sebastian ou d’autres sources de culture populaire. Pour l’image d’Aferim!, j’ai retenu la leçon de Kubrick, qui disait que chaque plan de Barry Lyndon était inspiré d’une peinture de l’époque. Au 19e siècle, de nombreux Français venaient en Roumanie pour peindre ou dessiner. Auguste Raffait, par exemple : on s’est beaucoup inspiré de sa peinture, pour les costumes mais aussi pour la mise en scène. C’était avant tout une manière de produire une distance.
C.N. — Le geste de puiser dans les seuls témoignages écrits et visuels de l’époque a donc une double fonction d’authenticité historique et de distanciation avec le présent.
R.J. — C’est une manière de rendre visible, très clair, le processus de représentation. C’est aussi comme ça que le film est devenu un western — le premier de l’histoire du cinéma roumain. En lisant les documents et les livres sur cette époque, j’avais souvent l’impression d’une caricature de western : la loi, les outlaws, les sauvages qu’étaient les Gitans, les Roms [...]
[...]
C.N. — Votre productivité est exceptionnelle parmi les cinéastes. J’ai l'impression que ce n’est pas seulement par tempérament, que c’est aussi une idée du cinéma, de ce que c’est « faire du cinéma », être cinéaste ?
R.J. — Je pense que c’est plusieurs choses. J’ai d’abord découvert empiriquement que je suis moins stressé si je travaille plus. Puis j’ai compris que c’est aussi une méthode qui permet de faire d’autres films. Aujourd’hui j’ai une petite théorie là-dessus : j’ai l'impression d’avoir cherché pour le cinéma une certaine vitesse qui, comme dans tous les arts, donne nécessairement des résultats différents. Bon ou mauvais, ce n’est pas la question. Évidemment tu ne peins pas la Chapelle Sixtine en trois jours. Mais si tu penses à Paul Klee par exemple : quand tu regardes ses tableaux, c’est évident qu’il travaillait vite, qu’un tableau ne lui prenait pas un an. Il faisait dix ou vingt tableaux chaque jour.
En Europe, le cinéma est très standardisé au niveau du financement. Tu écris des dossiers, tu finis par toucher un peu d’argent, après six mois ou un an tu as peut-être l’aide aux Cinémas du monde, six mois plus tard tu trouves peut-être un peu d’argent en Allemagne, après ça tu commences à préparer ton film. Et comme ça tous les trois, quatre, cinq ans. C’est ce que je veux éviter.
C.N. — Cela revient à dire que le rythme de production du cinéma n’est pas celui des cinéastes, qui en sont dépossédés. C’est le rythme imposé par un mode, un système de production et de distribution.
R.J. — Tout à fait. Enfin peut-être est-ce le rythme de certains cinéastes, sauf que si tu veux dix ans tu ne les auras pas, et si tu veux un an tu ne peux pas non plus, tu dois faire ton film entre trois et cinq ans. Parce que c’est le rythme de la production. Si je veux travailler sur un film pendant trois ans, très bien, mais si c’est parce que quelqu’un ou un système m’impose ce rythme, je suis contre. Et si tu regardes l’histoire du cinéma, tu réalises que le rythme de production a beaucoup ralenti. Le cinéma japonais des années 1930, la Nouvelle Vague, Fassbinder — qui est pour moi un modèle —, c’est la vitesse.
Lorsque l'on regarde l’histoire du cinéma, on réalise que le rythme de production a beaucoup ralenti. Le cinéma japonais des années 1930, la Nouvelle Vague, Fassbinder — qui est pour moi un modèle —, c’est la vitesse.
Radu Jude
C.N. — Quel serait son principal avantage ?
R.J. — Je pense que c’est moins névrotique. Plus tu attends entre les films, plus tu es stressé, plus le moindre geste devient compliqué — un grand statement. C’est ce que je veux éviter à tout prix. Bergman le dit dans le petit livre qu’il a fait avec Assayas : quand il était jeune, et même après, il était obligé par contrat de faire trois ou quatre mises en scène de théâtre par an, et il ne pouvait pas toujours choisir les pièces. Il dit que c’était très bien parce qu’ainsi il commençait à aimer certaines pièces qu’il pensait ne pas aimer. Et il ajoute : « C’était moins névrotique. » Il avait la première d’une mise en scène le vendredi soir, le lundi matin il commençait la nouvelle.
C.N. — Cette vitesse induit aussi un rapport au présent différent. Quand tu fais beaucoup de films, tu peux t’autoriser à en faire un pour la simple raison que tu as envie de faire ça maintenant, parce que c’est ça qui t’intéresse dans le monde. Dans deux ans ça ne t’intéressera plus mais là oui, et tu le fais.
R.J. — C’est ça. La vitesse détermine le choix du sujet et celui de l’expérimentation. Si je faisais un film tous les cinq ans, jamais je n’aurais fait Kontinental ’25. Tu ne travailles pas pendant cinq ans pour tourner un film en dix jours avec un téléphone portable. Mais pour moi, c’est aussi une question économique, parce que je ne suis pas producteur. Je gagne bien ma vie avec les films que je fais, mais je dois travailler. Je ne peux pas faire un film tous les cinq ans. Ou alors je devrais recommencer à faire des pubs ou de la télé, et je ne veux pas. Et ces questions se posent plus au cinéma que dans les autres domaines.
Je suis toujours gêné quand les gens me disent « tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de films ». Un peintre, s’il fait trois tableaux par jour, personne ne lui dit rien. Antonioni faisait un film tous les ans ou tous les deux ans, Fellini aussi, et c’étaient des films très ambitieux.
[...]
C.N. — En 2024 vous avez réalisé Sleep #2, hommage direct à Andy Warhol. Mais A Film for Friends, film de 2014 qui consiste en un unique plan fixe d’une heure, n’était déjà pas sans rapport avec son cinéma.
R.J. — Ah oui, c’est vrai ! Mais je ne connaissais pas Warhol quand j’ai fait cette tentative de film — à mon avis pas du tout réussie. Je l’ai fait de manière artisanale, avec des amis. C’est assez fou ce qu’il s’est passé sur le tournage. Le type qui a fait le faux sang pour le suicide raté du personnage est un ami, qui travaillait dans les effets spéciaux. Mais il faut savoir qu’en Roumanie tous ces gens sont autodidactes. Ils ont appris le métier en travaillant ici ou là, surtout sur des productions étrangères. Le cinéma roumain, en gros, c’est une bande d’amateurs. Pour le meilleur, mais parfois pour le pire.
Le cinéma roumain, en gros, c’est une bande d’amateurs. Pour le meilleur, mais parfois pour le pire.
Radu Jude
Pour ce film j’avais prévu de faire vingt prises. Cet ami a fait le faux sang en conséquence, avec un matériau facile à nettoyer, notamment pour le canapé. On a fait une première prise, trop longue — une heure, dont trente minutes avec le sang —, et pendant qu’on nettoyait pour préparer la deuxième prise, le comédien, Gabriel Spahiu, a commencé à se plaindre des yeux. Je lui ai dit d’aller aux toilettes se laver les yeux et au bout de quelques minutes il a commencé à hurler. Il avait très mal. J’ai demandé à l’ami qui avait fait le sang ce qu’il en pensait, il m’a dit : « je sais pas, je pensais pas que le sang irait dans ses yeux… » Il avait utilisé un détergent industriel très fort pour que ça soit facile à nettoyer. On a appelé l’ambulance, Spahiu est parti à l’hôpital où ses yeux ont été sauvés in extremis. Trente minutes plus tard, il les aurait perdus. Ils ont dû faire une intervention, après quoi il est resté deux semaines les yeux bandés.
Bref je n’ai pu faire que la première prise. Ce qui n’était pour moi qu’une répétition est devenu le film. Il est vrai que Warhol ne faisait toujours qu’une seule prise, on peut donc dire qu’en ce sens A Film for Friends est warholien. Mais j’ai longtemps été gêné par ce film, je le trouvais mal mis en scène, les dialogues pas bons, etc. J’ai quand même essayé d’en faire quelque chose mais personne ne voulait le montrer.
Quand Christian Mungiu (réalisateur de 4 mois, 3 semaines, 2 jours, Palme d'or lors du Festival de Cannes 2007, ndlr) a créé sa maison de distribution en Roumanie, il est venu me voir : « dis donc, ça pourrait m’intéresser de commencer mon travail de distribution avec ton film. » Mais quand il l’a vu, il a changé d’avis : « Mais ça va pas, comment tu peux imaginer que je vais sortir ce film ! » Plus tard, A Film for Friends a commencé à trouver des fans un peu partout. Christian Ferencz-Flatz a écrit un texte très intéressant qui parle de « remédialisation », de passage d’un média à un autre. Selon lui, mis sur YouTube, assumant jusqu’au bout son côté amateur, le film devenait plus fort que dans une salle de cinéma.
C.N. — C’est une idée intéressante parce que dans tes films vous pratiquez aussi la remédialisation, mais dans l’autre sens : vous importez vers le cinéma des médias comme Instagram, TikTok.
R.J. — C’est vrai. Ces derniers mois, je me suis de nouveau intéressé aux avant-gardes historiques, à leurs potentialités, et un de leurs gestes était celui-ci : prendre des choses n’importe où pour faire du nouveau. Mais la découverte de Warhol cinéaste, assez tard, il y a sept ans environ, a été un vrai choc. Pas seulement les films eux-mêmes, qui sont très inégaux comme tu sais, avec des chefs-d’œuvre et des films ratés, mais aussi deux autres dimensions plus théoriques.
D’abord son désir de revenir aux débuts du cinéma, à Lumière — dans une interview il parle d’Edison. Ensuite son geste de libération qui consiste à dire que le cinéma est facile, à la portée de tout le monde : tu prends une caméra, tu appuies sur le bouton, voilà, tu as un film. Même si je peux aussi résister à cette idée — quand j’ai découvert ses films je me suis dit que ce n’était pas si simple —, de plus en plus elle devient un recours pour moi. Quand je me sens bloqué, je pense à Warhol : il y a là une machine, si tu la laisses faire son boulot, ça va bien se passer, pas la peine de rester crispé.
C.N. — Pour les Screen Tests, il lui arrivait de partir et de laisser le modèle seul face à la caméra.
R.J — Oui, et comme dit Jonas Mekas, les Screen Tests sont une des grandes œuvres de portraitiste de l’histoire des arts visuels. Pour moi c’est surtout ça la leçon de Warhol : cette libération, et aussi l’idée de ne pas avoir peur d’une forme de bêtise, de stupidité — en anglais on dit « dumb ». Si tu prends la stupidité au sérieux, tu découvres que des gestes qui semblent stupides ont une grande portée philosophique. Cette libération par l’acceptation de la stupidité m’intéresse beaucoup. ◼
* Entretien entre Radu Jude et Cyril Neyrat, extrait du livre Radu Jude – La fin du cinéma peut attendre (Éditions de l’Œil, en coédition avec le FIDMarseille), sortie juillet 2025
À lire aussi
Dans l'agenda
Portrait du cinéaste roumain Radu Jude
Photo © Silviu Ghetie/Micro Film